Rencontre avec Kathleen Vanhandenhoven et Jean-François Pêcheur, les partenaires belges du réseau BIOCANTEENS !
Edited on
04 March 2021Jean-François Pêcheur (JFP) est coordinateur du GAL Pays des Condruses, asbl active dans le développement territorial de sept communes de la Province de Liège. Kathleen Vanhandenhoven (KV) y est responsable de projets en économie. Depuis 2018, le GAL est partenaire du réseau de transfert URBACT « BioCanteens ». Ce réseau, mené par la ville française de Mouans-Sartoux, vise à assurer la distribution de repas scolaires durables dans les villes participantes, en tant que levier essentiel pour le développement d'une approche agroalimentaire locale intégrée, protégeant à la fois la santé des citoyens et l'environnement. Le projet vise à transférer la bonne pratique de Mouans-Sartoux dans le domaine de la restauration scolaire collective à d'autres villes engagées à travers l'Europe.
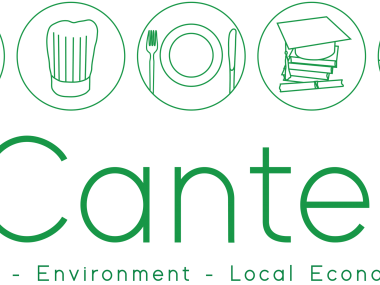
Quelle a été votre motivation de départ pour entrer dans un réseau URBACT ?
JFP : Cela faisait suite à notre première participation à URBACT, au sein du projet AGRI-URBAN, un réseau de planification d’action. Dans notre plan intégré d’actions figurait tout un pan sur la thématique qu’on a développé ici, donc les cantines durables. C’est la suite logique du travail que nous avions mené sur 2016-2018. Cela venait renforcer une dynamique existante. Par ailleurs, le partenaire était tout trouvé puisque notre chef de file était déjà dans le premier partenariat. Ça a été plutôt une continuité d’un travail entamé en 2016.
Donc la thématique des cantines bio scolaires était une priorité pour vous ?
JFP : On avait intégré toute une série d’actions sur le renforcement de nos projets de cantines bio sur le territoire. Par ailleurs, Mouans Sartoux a été sollicité pour être chef de file d’un réseau de transfert. Nous n’avons pas été en phase 1 mais dès que la phase 2 a été ouverte, on était prêts. Et du côté de Mouans, ils avaient apprécié le travail qu’on avait mené de concert donc il y avait une certaine logique.
Et par ailleurs, ce sont des moyens supplémentaires qui nous permettent de travailler sur cette question. Mais au-delà des moyens, je pense que c’est vraiment le cadre apporté par URBACT qui est important : on est dans un projet et on va vraiment travailler le projet. Tandis que sur d’autres actions qui étaient dans notre plan d’action intégré (PAI) dans lesquelles il n’y a pas ce cadre formel de travail, on est un peu moins loin. On a planifié des activités à un moment t mais nous avons des ressources limitées et on ne sait pas embrasser tous les projets qui étaient dans notre plan d’action.
Par contre, ici, il y a le cadre formel qui t’oblige à avancer, avec une structure bien claire en modules. Le fait de participer à un projet, notamment URBACT, ça t’oblige à te mobiliser et à mobiliser tes parties prenantes.
Sur la question de la tarification sociale, par exemple, on avait déjà identifié cet enjeu en 2016. On s’est dit que c’était vraiment crucial en termes de gouvernance du territoire. Et on a pu avancer étape par étape avec Anthisnes et maintenant, on va essayer de travailler avec les six autres communes du territoire. Et ça c’est grâce à URBACT, clairement !
Plus concrètement, quels sont les projets que vous avez mis en place grâce au projet URBACT ?
KV : Ici, c’est vraiment un échange de bonnes pratiques. Donc on a analysé la bonne pratique de la cantine de Mouans Sartoux. Elle a été déclinée en différents modules. Et à chaque rencontre, on a travaillé sur un module pour voir comment on pouvait adapter cette bonne pratique dans nos contextes, propres à chaque pays.

Réunion transnationale à Trikala 14-17 octobre 2019
De notre côté, il y avait des modules sur lesquels on était déjà bien avancé, d’autres sur lesquels on n’avait pas encore travaillé, notamment par exemple la tarification sociale même si ça faisait partie des objectifs qu’on avait.
Parmi les 8 modules, il y a la mise en place d’une ferme municipale – nous l’avons décliné avec quelqu’un qui produit des légumes sur 30 ares au sein de notre espace test et donc toute sa production est vraiment dédicacée à la cantine, chose qui n’était pas du tout structurée comme ça avant.
On a aussi travaillé aux bonnes pratiques en cuisine : quand la cantine s’est développée sur notre territoire, on avait la chance de déjà connaître Mouans-Sartoux grâce à l’ancien réseau. L’échange avec l’ensemble des partenaires européens a inspiré le fait d’en rajouter l’une ou l’autre dans la cantine, notamment l’acquisition d’un matériel plus performant qui permet de gagner pas mal de temps en cuisine. C’est aussi adopter plus régulièrement un menu végétarien : ce n’est pas uniquement supprimer la viande mais aussi, inclure des légumineuses, par exemple, pour aller un cran plus loin.
Il y avait aussi tout ce qui était visibilité : jouer sur l’offre et la demande. On avait déjà mis en place une plateforme de visibilité pour les acteurs économiques (Moncondroz.be). Les producteurs sont mis en avant grâce à des badges bio, à des badges produits locaux, à la participation à des événements locaux de type marchés ou fêtes rurales. Dès la mise en place de la cantine, nous avons été consultés et nous avons partagé la liste des producteurs locaux afin de favoriser les partenariats possibles pour l’approvisionnement de la cantine. Après, tout ce qui est gouvernance, c’est un de nos points faibles.
On a démarré avec la politique de tarification sociale qui a directement été mise en place sur la commune d’Anthisnes. Les retours sont super positifs après cette première phase de test, donc on voudrait proposer aux autres CPAS (centre public d’action sociale) d’entrer dans la démarche. Mais on a été bloqué par le premier confinement et la fermeture des cantines… et puis par le deuxième confinement. Et on ne sait pas encore quand les cantines scolaires seront réouvertes…
Un autre module sur lequel nous avons travaillé, c’est la souveraineté alimentaire. On a fait un petit exercice de projection : « si en 2040, on veut nourrir notre population avec des produits locaux, de combien de terres aurons-nous besoin ? ». On a à nouveau fait l’exercice sur Anthisnes. En gros, on peut considérer qu’on a les terres nécessaires mais à y regarder de plus près, toutes ne sont pas propices à de la production alimentaire. Il y a d’autres choses à faire : de la sensibilisation auprès des propriétaires terriens pour qu’ils mettent ces terres à disposition, travailler sur le bail à ferme (partenariats avec Terre-en-vue) mais aussi sensibiliser les agriculteurs à faire de la diversification ou de la conversion, pour qu’une partie de leur production puisse servir aux circuits courts. On avait projeté des séances de sensibilisation : inviter des agriculteurs qui sont passés en circuits courts à venir témoigner de leur conversion mais aussi, c’est très important, de toutes les difficultés qu’ils ont dû dépasser. Je trouve qu’il est important de ne pas dresser un tableau idyllique de la conversion.
Ça rejoint d’autres thématiques qu’on aimerait développer avec notre espace test. Cela fait effet levier de pouvoir travailler sous différents axes : alimentation ou installation au maraichage comme on le soutient avec notre espace test.

Présentation de l’espace test aux partenaires Biocanteens, lors du transnational meeting organisé par le GAL Pays des Condruses du 6 au 9 mai 2019.
Par rapport à ces thématiques qui intéressent beaucoup d’acteurs publics aujourd’hui, est-ce que vous êtes interpellés pour présenter vos projets ?
JFP : L’asbl Devenirs, qui gère ce projet de cantine durable, a reçu beaucoup de visites afin de comprendre leur philosophie de travail, l’organisation au quotidien de la cantine, etc. Le projet vise le 100% bio et local et est en passe de l’atteindre. Il y a aussi des collaborations sur cette thématique avec le GAL voisin « je suis hesbignon ». Il y a pas mal d’éléments qui percolent.

Visite des Jardins de Devenirs, formation en maraîchage et horticulture, avec les partenaires Biocanteens, lors du transnational meeting organisé par le GAL Pays des Condruses du 6 au 9 mai 2019.
Sur tout ce qui est « hall relais – Food hub », « coopérative agricole », on est souvent interpellés au niveau européen par des gens intéressés par ce qu’on a développé. Idem pour notre espace test.
C’était un des objectifs qu’on s’était fixé dans notre PAI (en 2018), c’était de retravailler la question des compétences, de la formation au sein de notre espace test. Et là, on a introduit l’année dernière un projet Erasmus+. C’était un des acquis de la première phase : diversifier les sources de financement. Malheureusement, il n’a pas été sélectionné. C’est aussi un des acquis d’URBACT, c’est de ne pas avoir peur de se lancer dans des projets européens. On structure des réseaux, même parfois informels d’acteurs, et c’est une réelle plus-value.
Albert Deliège (Devenirs) a été interpellé par la ville de Huy et à moyen terme, des services seront proposés aux écoles de la ville. Il n’y a pas l’idée de recréer une structure qui va préparer 10.000 repas mais ici il y a une taille critique qui est atteinte avec la production de 1.000 repas. On ne va pas devenir une mégastructure. S’il y a d’autres territoires intéressés, ils doivent créer leur propre structure. C’est la logique de la résilience : on n’essaye pas de réduire les coûts. Si tu restes à une échelle correcte, tu peux continuer à faire ton travail dans le respect de la chaine d’approvisionnement, des producteurs et continuer à entretenir des relations privilégiées avec tes écoles et ta clientèle. C’est aussi un des acquis de ce projet.
L’influence sur le récit, l’histoire : aujourd’hui le récit médiatique s’empare des questions qu’on traite localement depuis 10 ans et ça bouscule le mainstream ! Produire une vidéo sur les cantines, sur d’autres activités, ça contribue à la construction du récit et à ce que les gens adhèrent progressivement à ces pratiques qui bousculent les habitudes.
Quels sont les résultats que vous avez déjà sur le terrain ?
JFP : Pour le plan de transfert, on a travaillé par modules en faisant déjà les choses sur le terrain. Si on prend la question du tarif social, on a déjà testé une première expérience. Nous, on travaille avec sept conseils communaux, et donc c’est étendre cette bonne pratique.
Sur les questions de souveraineté alimentaire, si on veut vraiment avancer, il faut quelqu’un qui travaille dessus pendant plusieurs années parce qu’on se heurte à des questions complexes dès que l’on quitte la sphère des intentions. L’idée est plus que louable, mais quid de sa réalisation ? Quid de la maîtrise foncière ? Quid des contrats existants entre propriétaire et locataire du foncier agricole ? Quid de la réorientation de certaines cultures ou spéculation agricole alors qu’une exploitation agricole est un paquebot délicat à manœuvrer et qu’un changement de cap nécessité un accompagnement et pas mal d’essai-erreurs, etc.

Travail sous-groupe sur la souveraineté alimentaire lors du transnational meeting à Vaslui du 16 au 19 septembre 2019.
Comment se passent les échanges au sein du réseau ?
KV : C’est sûr que les échanges et l’inspiration vont dans tous les sens. Mais dans ce réseau-ci, les autres cantines étaient beaucoup moins avancées que nous. Les autres étaient plus en demande de bonnes pratiques parce qu’ils essayaient de mettre en place. Au niveau de l’animation dans les écoles, en Italie, par exemple, ils invitaient les parents à venir manger avec les enfants le jour de l’anniversaire d’un enfant qui était vraiment mis à l’honneur. C’est vraiment une sensibilisation au niveau de la famille aussi pour faire évoluer les pratiques alimentaires de manière plus globale.
JFP : Dans certains pays de l’est, ils démarraient vraiment. C’était parfois un peu surprenant. Ils en étaient à trouver des petits lopins de terre.
KV : Au Portugal, la culture bio n’est pas du tout développée. Ils sont dans des grandes cultures conventionnelles donc ils devaient vraiment démarrer toute la sensibilisation, travailler avec un tout petit centre de formation.
JFP : On voit que le réseau a quand même pas mal décloisonné en termes de bonnes pratiques… En matière de bio, par exemple, en Bulgarie et Roumanie, ils sont peu avancés… Ce qui est complexe, c’est le cadre dans lequel ils doivent organiser la cantine, avec, par exemple, des quantités en viande obligatoire complètement démesurées. C’est le cadre national qui l’impose, avec beaucoup de gaspillage alimentaire. Mais progressivement, ils intègrent du bio, ils développent des relations avec leurs producteurs locaux. Le projet permet d’avancer sur le récit et on verdit l’alimentation des enfants au quotidien !
KV : Ce qui m’a aussi étonné c’est que dans tous ces pays, la cantine est un projet municipal. C’est la municipalité qui gère la cantine. Tandis que chez nous, pas du tout. Et nous, on essaye d’impliquer nos communes dans nos cantines, c’est vraiment le cheminement inverse.
JFP : Un autre enjeu plus macro de ce projet-ci, c’était une volonté de Gilles Pérole, l’adjoint au Maire de Mouans, qu’il porte notamment via l’association A+bio en France. C’était de faire en sorte que l’alimentation soit une exception, comme l’exception culturelle. Sortir la question de la fourniture des cantines des marchés publics, de la logique du moins-disant. Ne plus devoir jouer de subterfuge : on devrait pouvoir travailler avec des gens dans un périmètre défini dans une relation contractuelle.
KV : D’autant plus que les petits producteurs souvent n’ont pas envie de répondre aux marchés publics et donc on ne reçoit que les offres des grosses structures…
JFP : L’objectif c’est d’aller sensibiliser les élus européens à l’exception alimentaire avec l’intention d’organiser un événement au Parlement européen ou dans un autre organe satellitaire. Ça devait être l’aboutissement de ce projet BIOCANTEENS… Wait and see.

Photo de groupe des partenaires Biocanteens, avec Marc Tarabella (député européen en charge du Développement et de l'Agriculture), devant l’administration communale d’Anthisnes, lors du transnational meeting organisé par le GAL Pays des Condruses du 6 au 9 mai 2019.
Par rapport à la suite, qu’envisagez-vous pour l’avenir ?
JFP : Pour le projet de cuisine sur lequel la stratégie est assez claire, l’objectif est de produire 1.000 repas/jour. Sur l’espace test, on a toujours cette volonté de collaborer avec les autres partenaires européens pour continuer à améliorer la qualité du service qu’on apporte à nos collaborateurs.
Qu’attendez-vous d’un événement avec les autres villes URBACT belges impliquées dans un réseau de transfert ?
JFP : Je pense qu’il y a deux choses. Ce que l’on peut amener au réseau, avoir les gens du Green Deal wallon autour de la table, par exemple, et d’autres villes intéressées par la thématique des cantines durables. Et ensuite, en termes de méthodologie, voir comment chacun a travaillé pour que les bonnes pratiques soient diffusées ou se matérialisent au sein de leur ville. On pourrait aussi comparer ces méthodologies : un éclairage, une comparaison des méthodes de travail qui pourraient être inspirantes.
Il serait aussi intéressant de discuter des résultats, impacts plus macro que l’on souhaite atteindre, qui ne sont pas forcément définis dès le départ dans les modules de transfert ? Comme nous avec l’exception alimentaire dans les marchés publics : comment chacun-e essaye de faire bouger les cadres, les lignes sur leur thématique à différents échelons de pouvoir ?
 Submitted by Fabian Massart on
Submitted by Fabian Massart on
